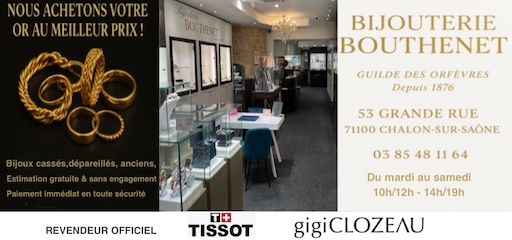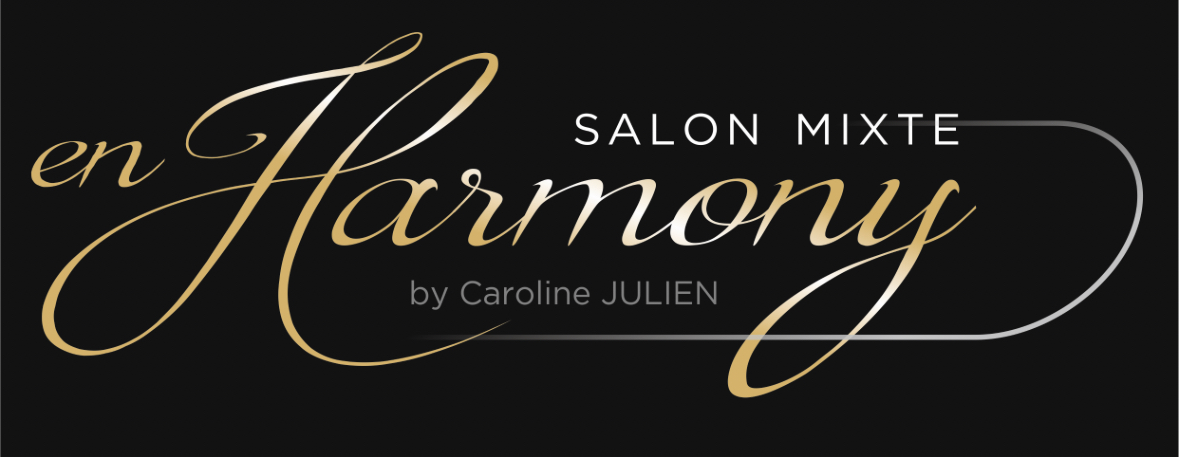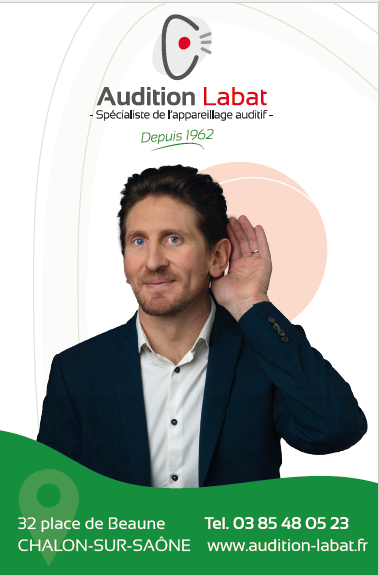Saône et Loire économie
Volailles de Bresse à volonté !
Publié le 11 Septembre 2015 à 20h10

A volonté : poulets, dindes, pintades, chapons… le tout labelisés AOC volailles de Bresse. L’offre est alléchante n’est-ce pas ? Problème, ce n’est pas pour les consommateurs ! Non, il s’agit en réalité de la prédation croissante des renards, fouines, autours des palombes, blaireaux, corneilles, buses... qui se régalent, voire « se spécialisent ».
Le 4 septembre, les éleveurs ont alerté le préfet de Saône-et-Loire. Gilbert Payet envisage donc de prendre un arrêté et ainsi peut-être autoriser les tirs de renards de nuit autour des exploitations. A condition surtout que les acteurs se coordonnent sur le terrain.
A Branges, le Comité interprofessionnel de la volaille de Bresse (CIVB) rappelait que la prédation atteint désormais 10 % des mises en production, contre 6 % auparavant (2000). Un pourcentage qui cache de fortes disparités d’un élevage à l’autre. Six éleveurs en témoignaient. Les conséquences sont diverses. Eleveur à Romenay, Emmanuel Bertrand a du « réduire la voilure » à 40.000 volailles. L’équilibre économique forcée s’est fait au détriment d’un salarié. Ses pertes annuelles dues aux prédateurs sont en effet bondies de 6 à 15 % de ses mises. « Début juin, j’ai même eu un pic de 140 morts autour d’un poulailler à cause de renards ». Ses 45 ha de parcours sont pourtant électrifiés. L’implantation de maïs autour n’a pas non plus résolu le problème des attaques. Responsable de l’exploitation de la ferme de Viennette (ESAT) à Montret, Philippe Pillot a lui installé des caméras pour identifier les prédateurs rôdant autour. Le sous-préfet de Louhans et le préfet de Saône-et-Loire visionnaient les vidéos montrant renards, fouines et blaireaux se faufiler à travers un seul et même trou dans le grillage. Il déplore 25 à 30 % de pertes sur un total de 10.000 mises. Ce qui avait le don d’énerver Cécile Palenzua. Même combat pour elle qui est piégeuse agrée et qui a 33 renards et 6 corbeaux à « son actif ». « Chez moi, c’est 20 % de prédation. C’est une catastrophe pour moi qui fait 5.000 volailles par an », expliquait-elle. Après les chats sauvages, les corneilles… c’est « toutes sortes de rapaces » qui se "spécialisent" en volailles de Bresse. « Les buses attaquent cinq minutes après avoir ouvert les trappes », constatent-elles impuissante. Plus tôt dans la matinée à Varennes-saint-Sauveur, Gilbert Payet avait également pu constater que les dégâts peuvent être découvert au moment de l’abattoir. « L’autour des palombes laissent les animaux vivants. Il ne touche pas les parties vitales mais mange les filets. Les corbeaux eux aiment le sang. Les poulets font les morts en se mettant sur le dos », expliquait alors Jean-Claude Marquis. Des volailles blessées et stressées qui, dès lors, hésitent à sortir sur le parcours et s’alimentent moins. Elevant 35.000 volailles à Sens-sur-Seille, Thierry Jallet estime ses pertes au final entre 15.000 à 18.000 € par an. Sans compter les heures - de jour comme de nuit - à faire des rondes de surveillance…
Un lourd tribut
Et les manques à gagner ne sont pas uniquement sur ce poste. A Sornay, Philippe Buatois élève 18.000 volailles et est dans la moyenne des 10 % de pertes annuelles. La société de chasse est « efficace » là-bas, félicitait-il. Mais des « nuées » de corbeaux provoquent de véritables « carnages » jusqu’au dernier champs de maïs semé. Et ce, malgré les tirs de canons pour les effaroucher. « Les corbeaux s’y sont habitués ». Avec la FDC 71, le CIVB incite aussi tous "leurs" éleveurs à devenir piégeurs agréés.
Ainsi, tous exprimaient la même inquiétude profonde de devoir un jour être contraint de « mettre la clé sous la porte » si la prédation continue d’augmenter. De l’entreprise Mairet, le directeur, Jean-Vincent Mathieu allait plus loin : « cela coûte aux éleveurs et c’est autant de volailles qui ne rentrent pas dans notre usine ».
Conscient de tous ces problèmes, le sous-préfet de Louhans, Georges Bos a déjà réuni à deux reprises depuis sa prise de fonction, les éleveurs et associations de défense des oiseaux pour envisager des solutions. Sauf que toutes ces solutions d’effarouchement jusqu’à présent « ne marchent pas »…
Renards : tirs de nuits envisageables
Se tournant vers les deux officiers de l’office national de la chasse et de la faune sauvage (OFNCFS), le préfet de Saône-et-Loire cherchait donc à savoir quels moyens pouvaient désormais être mis en place ? Avant les réponses, il se montrait visiblement non favorable à des battues administratives à « l’impact temporaire et localisé », selon le bilan de ses services sur le sanglier notamment. Luc Texier, chef de service de l’OFNCFS à Montceau-les-Mines, insistait donc sur le fait qu’à ce jour, « il n’y a aucun véritable plan de lutte contre le renard », principal prédateur recensé ici. Le sous-préfet, Georges Bos intervenait pour rappeler qu’une « réflexion » a aussi été lancée avec la fédération départementale de la chasse (FDC 71) pour « inciter » d’avantage (récompenses à la queue…) les chasseurs. L’OFNCFS estime cependant qu’autour des exploitations labelisées AOC Bresse, « avant d’envisager des tirs de nuit, des actions combinées aux mois d’avril-mai, peuvent apporter une réponse technique ». Le préfet de Saône-et-Loire souhaite maintenant des moyens « réalistes », des réponses locales et du concret : « qui fait quoi et combien de temps ». Des réunions en préfecture et sous-préfecture seront organisées. Il se montrait également ouvert pour expérimenter « là où la prédation est la plus importante » des tirs de nuits des renards rôdants « 200 mètres autour » des parcours des volailles AOC. A suivre…
Maison Marquis à Varennes Saint Sauveur
Le sens du détail
Depuis maintenant 30 ans, Jean-Claude Marquis est passionné par l’élevage de volailles de Bresse AOC. Pendant près de deux heures, il a expliqué son métier au préfet de Saône-et-Loire : de la sélection génétique au centre de Béchanne jusqu’à son nouvel atelier de transformation, en passant par la finition en épinettes. Sur son exploitation, il cultive ainsi du blé et du maïs "blanc" cornu séché à basse température sur place pour l’alimentation des volailles. Une autoproduction complétée par du lait « provenant de la laiterie de Varennes-saint-Sauveur », principale source des beurres et crèmes AOC de Bresse. Réparties dans une vingtaine de bâtiments, les gallinacées se régalent aussi sur les 17 ha de parcours herbeux aménagés. Le cahier des charges obligeant un minimum de 10 m2 par volaille. A 67 ans, Jean-Claude a aussi su moderniser une partie des tâches répétitive comme avec ses deux distributeurs (gaveuses) – sur batterie – pour le lait ou les céréales. « Je rajoute des graines de sarrasin, elles en raffolent », lui qui dit – rejoignant la tradition d’un élevage féminin au départ -, avoir appris auprès de « Jeannine, le sens du détail, pour toujours faire attention à les faire manger » correctement. Côté bien-être aniaml, les brumisateurs ont aussi servi à « choyer et bien soigner » les volailles par les fortes chaleurs estivales. Et cela se ressent à la fin. « Je prépare mon produit en pensant toujours au consommateur. Après, je regarde évidemment mon coût de production car je dois en vivre. Mais, il faut que le client reviennent pour le produit, pas qu’il retienne le prix », expliquait-il au préfet sur la question des cours sur les marchés.
Finalement, sa plus grande crainte est ailleurs. Du côté de la prédation lui qui constate jusqu’à 20 % de pertes par lot. Il regrette que l’assomoir soit désormais interdit. En effet, il a récemment vécu une « grosse attaque » de fouines – ayant pénétrées dans un bâtiment - laissant 82 volailles « bouffées ». Il indiquait également qu’avec la sécheresse estivale, ses chapons voulaient rester dehors. « Je me suis raté deux fois. 4-5 restaient alors dehors. Le lendemain matin, ils étaient tous morts ». La faute à une famille de renards. La mère apprenant à ses renardeaux à chasser. « Je les voyais la nuit mais c’est interdit en Saône-et-Loire de tirer les renards la nuit », expliquait-il au préfet. Gilbert Payet s’engageait donc à « trouver des solutions » réglementaires « du moment où est fait la preuve absolue que l’espèce n’est pas menacée ».



-
 Violents orages sur l'Yonne ce mercredi en fin d'après-midi
Violents orages sur l'Yonne ce mercredi en fin d'après-midi -
 Un bénévole de la SPA témoigne
Un bénévole de la SPA témoigne -
 Changement de nom et de propriétaires pour le restaurant de la Roseraie qui s’appelle dorénavant ‘La voile’
Changement de nom et de propriétaires pour le restaurant de la Roseraie qui s’appelle dorénavant ‘La voile’ -
 Le Commandant Chottin, chef d'escadron de la compagnie de Chalon-sur-Saône, quitte la gendarmerie de Chalon pour reprendre des études à Strasbourg.
Le Commandant Chottin, chef d'escadron de la compagnie de Chalon-sur-Saône, quitte la gendarmerie de Chalon pour reprendre des études à Strasbourg. -
 Un A 400 M à très basse altitude a survolé la Côte Chalonnaise
Un A 400 M à très basse altitude a survolé la Côte Chalonnaise -
 Les premiers orages ont frappé l'Allier et l'Ouest du Morvan
Les premiers orages ont frappé l'Allier et l'Ouest du Morvan -
 Belle frayeur après un incendie criminel devant le CIFA de Mercurey
Belle frayeur après un incendie criminel devant le CIFA de Mercurey -
 Clin d'oeil à une revenante sur le Chalonnais
Clin d'oeil à une revenante sur le Chalonnais -
 "Vous n'avez pas oublié quelque chose sur les quais ?"
"Vous n'avez pas oublié quelque chose sur les quais ?" -
 Chalon-sur-Saône : Le championnat de France pétanque doublette mixte a commencé
Chalon-sur-Saône : Le championnat de France pétanque doublette mixte a commencé -
 CANICULE - Fermetures d'écoles annoncées en Saône et Loire et en Côte d'Or
CANICULE - Fermetures d'écoles annoncées en Saône et Loire et en Côte d'Or -
 "Gilles Platret ou la trumpisation sauce bourguignonneGilles Platret ou la trumpisation sauce bourguignonne"pour les Insoumis de Chalon sur Saône
"Gilles Platret ou la trumpisation sauce bourguignonneGilles Platret ou la trumpisation sauce bourguignonne"pour les Insoumis de Chalon sur Saône -
 Préavis de grève à l'Ehpad du Bois de Menuse à Chalon sur Saône
Préavis de grève à l'Ehpad du Bois de Menuse à Chalon sur Saône -
 Lancement réussi pour la 10e édition des Guinguettes (Chalon au fil de l’été)
Lancement réussi pour la 10e édition des Guinguettes (Chalon au fil de l’été) -
 A 400 M - Un autre cliché impressionnant au-dessus de Mellecey
A 400 M - Un autre cliché impressionnant au-dessus de Mellecey -
 ELAN CHALON - Que la fête fut belle autour de "Monsieur Collin"
ELAN CHALON - Que la fête fut belle autour de "Monsieur Collin" -
 L'Eglise du Sacré-Coeur de Bourbon-Lancy lourdement endommagée après l'orage de mercredi soir
L'Eglise du Sacré-Coeur de Bourbon-Lancy lourdement endommagée après l'orage de mercredi soir -
 incendie devant le CIFA - 2 ans de prison assortis d’un sursis probatoire renforcé, pendant 3 ans pour le jeune apprenti à l'origine
incendie devant le CIFA - 2 ans de prison assortis d’un sursis probatoire renforcé, pendant 3 ans pour le jeune apprenti à l'origine -
 La belle surprise réservée à "Monsieur Collin" dans la cour du lycée Emiland Gauthey
La belle surprise réservée à "Monsieur Collin" dans la cour du lycée Emiland Gauthey -
 Après trois ans au refuge Ernest-L’Henry, Stitch rejoint une famille qui croit en lui
Après trois ans au refuge Ernest-L’Henry, Stitch rejoint une famille qui croit en lui -
 Mobilisation générale ce jeudi autour du Collège du Petit Prétan à Givry
Mobilisation générale ce jeudi autour du Collège du Petit Prétan à Givry -
 Championnat de France pétanque doublette mixte : Richard Feltain et Valérie Labrousse (Dordogne) ‘Champions de France’
Championnat de France pétanque doublette mixte : Richard Feltain et Valérie Labrousse (Dordogne) ‘Champions de France’